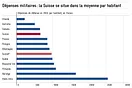Le Japon a récemment transmis à ses universités des directives recommandant d’«orienter les jeunes de 18 ans vers des domaines hautement utiles où la société est en demande». Dans le collimateur : les sciences humaines et sociales (SHS), avec la conséquence prévisible et souhaitée (par le gouvernement) d’une drastique réduction des dépenses universitaires dans ces domaines. Le Japon fait donc un choix de priorités: les formations répondant bien à la demande du marché du travail seront mieux financées que les autres. En Suisse, l’UDC propose de diviser par deux le nombre d’étudiants dans les SHS ou d’y instaurer un numerus clausus, au motif que ces étudiants ne trouveraient pas d’emploi à leur sortie de l’Université.
Le cas japonais interpelle, car il rappelle crûment que les hautes écoles n’ont pas de ressources illimitées ni de budgets extensibles à l’infini. Même dans la prospère Suisse, elles doivent fixer des priorités pour leur financement. Mais selon quels critères décider ? Privilégier les filières les plus porteuses sur le marché de l’emploi ? Réduire le financement de celles qui « génèrent » le plus de chômeurs ? Plus de médecins, moins de sociologues ? Encore plus de juristes ?
Le critère de l’utilitarisme sur le marché de l’emploi doit être pris en compte pour définir des priorités de formation : il n’est pas absurde que la Suisse affecte une part croissante de ses dépenses universitaires pour former des informaticiens ou des médecins, plutôt que des linguistes ou des Egyptologues. Mais ce critère ne tient pas compte d’autres dimensions de transmission du savoir, considéré comme un rôle de civilisation. Et il serait totalement contre-productif dans la recherche : condamnés à devoir prouver des résultats économiques, les chercheurs vivraient dans la hantise de l’échec, inhibant ainsi tout esprit d’innovation.
De nombreuses disciplines universitaires, dont les SHS, n’échapperont pas à une réduction de leurs ressources financières. Plutôt que d’y voir à chaque fois une «guerre contre le savoir», la Suisse devrait prendre en compte quelques dimensions nouvelles :
- la qualité prime plus que la quantité. La Suisse compte cinq institutions universitaires classées dans le Top 100 mondial. La préservation d’un tel résultat exige une concentration des ressources financières sur quelques filières du plus haut niveau. Le Japon n’a que deux Universités dans ce classement, alors que le pays compte près de 180 universités publiques.
- la «vraie» concurrence dans l’excellence est internationale, et non plus interne à la Suisse. Les SHS doivent créer des pôles d’excellence nationaux, et ne pas disperser les efforts et les chaires, sous couvert de maintien d’une Université «généraliste», un concept flou qui masque souvent l’incapacité à faire des choix.
- l’accès au savoir international doit être favorisé et préservé. La Suisse n’a pas les moyens d’exceller dans tous les domaines. Mais une renonciation à financer nationalement une discipline ne signifie pas un abandon complet : la Suisse doit tenter de garantir l’accès de ses chercheurs et étudiants les plus motivés aux meilleures filières du monde, à l’étranger (par un système de bourses et d’accords). Bien entendu, une telle politique exige la réciprocité et l’accueil en Suisse d’étudiants étrangers dans nos propres filières d’excellence.
- le savoir universel n’a jamais été aussi aisément accessible. La transmission du savoir ne doit plus nécessairement être assumé physiquement et localement pour chaque discipline dans chaque institution. Le développement des formations en ligne (MOOCs, pour «massive open online courses») permet aux hautes écoles une large et efficace dissémination du savoir. L’EPFL, mais aussi les Universités de Genève et de Lausanne, sont des pionniers en la matière. Inversement, chaque résident en Suisse a accès aux MOOCs du monde entier. Le rôle de transmission et de préservation du savoir peut donc être partiellement assumé sous des formes moins onéreuses que le financement classique des hautes écoles actuelles.
Cet article est paru le 10 octobre 2015 dans Le Temps sous le titre «Faut-il réduire les sciences humaines?». Le point de vue de Tibère Adler, Directeur romand d'Avenir Suisse, a été présenté face à celui de l'éditeur Markus Haller.