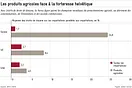Le colloque d’automne de cette année avait pour thème «Les effets d’une politique monétaire non conventionnelle». Gerhard Schwarz, le directeur d’Avenir Suisse, a ouvert le colloque avec l’adage «l’argent régit le monde». Mais alors qui contrôle l’argent ? Et avec quelles répercussions ?
Trois personnalités étroitement liées à la politique monétaire ont présenté un exposé et discuté du sujet : William R. White, ancien chef économiste de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui a été l’un des premiers à mettre en garde contre les risques d’une politique monétaire ultra-expansionniste, Leszek Balcerowicz, ancien président de la Banque nationale de Pologne et ministre des finances sous Tadeusz Mazowiecki qui a contribué avec succès au processus de transformation de la Pologne vers une économie de marché, et enfin Thomas Jordan, président de la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS).
Un problème de dettes et non de liquidités
William White a commencé par critiquer vivement la politique monétaire ultra-expansionniste des banques centrales, qui repose selon lui sur de fausses hypothèses. L’économie mondiale ne souffre pas d’un problème de liquidités, mais plutôt d’un problème de solvabilité. Ce dernier doit être résolu au niveau politique. Malheureusement, les politiciens se sont cachés derrière les banques centrales, qui ont la responsabilité de gérer les problèmes de liquidités, en leur confiant des tâches qu’elles ne sont pas en mesure de remplir.
Il n’est donc pas surprenant que la stimulation de la demande visée par la politique monétaire ultra-expansionniste n’ait pas été couronnée de succès. «Les intérêts excessivement bas déstabilisent l’économie et répandent un vent de panique». A la suite de l’assouplissement quantitatif, une «répression financière», comprenant l’obligation d’investir dans des emprunts d’Etat, menace, ce qui est plutôt de mauvais augure pour les investissements dans les entreprises. En outre, la consommation privée est freinée par l’endettement croissant des ménages. Dans les faits, le taux d’endettement global a augmenté de 20% depuis 2007 ; il n’y a donc aucune trace de réduction des dettes. Des banques exsangues continuent à financer des entreprises exsangues, tandis que les prix de nombreux actifs ont augmenté à des niveaux nécessitant une correction à la baisse.
Ce problème est aggravé par le fait que les principales régions économiques connaissent une situation difficile : aux Etats-Unis, le taux d’épargne est trop bas, tandis que la zone euro doit faire face à d’importants problèmes structurels. Les économies émergentes, qui avaient jusqu’à présent un endettement relativement faible et un grand potentiel de croissance, − éléments qui auraient pu contribuer à la résolution du problème − sont devenues elles-mêmes une partie de celui-ci. Elles se trouvent en difficulté surtout en raison de l’endettement accru de leurs entreprises.
Plus les banques centrales tardent à se défaire des liens imposés par les politiques, plus la sortie de la politique monétaire ultra-expansionniste devient difficile. Ce qui pose la question des perspectives à venir. Une issue positive à la crise actuelle n’est certes pas exclue, mais selon William White, la probabilité d’aboutir à un dénouement tumultueux, avec de graves conséquences pour l’économie mondiale, est plus élevée.
L’interventionnisme étatique à l’origine de la crise
Leszek Balcerowicz, aujourd’hui professeur à la Warsaw School of Economics, n’a guère fait preuve de plus d’optimisme. Il voit l’origine principale de la crise financière et de la crise de la dette non pas dans le système de marché, mais dans l’interventionnisme étatique croissant, qui a conduit au final à une déstabilisation économique et sociale générale. Il a étayé cette assertion avec les exemples des «enclaves socialistes» comme Fannie Mae et Freddie Mac aux Etats-Unis, les banques régionales en Allemagne et les «Cajas» en Espagne. Selon lui, il est aberrant d’imputer le blâme des crises au capitalisme, alors que les plus grandes chutes de croissance ont eu lieu dans des autocraties socialistes. Une mauvaise politique économique est le plus souvent le résultat d’une mauvaise réglementation telle que le cadre réglementaire surdimensionné de Bâle. La question centrale est donc : comment peut-on éviter une mauvaise politique économique ? La réponse de Balcerowicz est simple : «plus on réussit à tenir la politique éloignée des leviers de commande de l’économie, meilleures seront les conditions de croissance».
Concernant l’UE ou la zone euro, Balcerowicz s’est montré peu confiant. D’une part, la politique monétaire non conventionnelle de la BCE n’est pas un «free lunch» et elle ne peut pas remplacer des réformes fiscales et structurelles. D’autre part, les réformes «top-down» ne sont pas une solution pour l’Europe, car les pays se différencient trop en matière de compétitivité et de croissance. Les problèmes structurels français ou italiens ne peuvent pas être résolus par une union fiscale. Les seuls exemples positifs d’unions fiscales sont, pour Balcerowicz, l’Australie, les Etats-Unis et la Suisse, grâce aux clauses constitutionnelles de «no bail-out» (pas de garanties de renflouement financier).
Une perspective positive marquée par une certaine réserve
Après les perspectives moroses des orateurs précédents, il incombait à Thomas Jordan de faire revenir un peu d’espoir. Le point de départ de son exposé a été la comparaison de certaines valeurs de référence au début de la crise financière en 2007 avec celles d’aujourd’hui.
| Octobre 2007 | Octobre 2015 | |
| Objectif pour le Libor à trois mois | 2,75% | −0,75% |
| Avoirs en comptes de virement détenus par les banques à la BNS | 5 milliards CHF | 399 milliards CHF (au 2 oct.) |
| Bilan de la BNS en % du PIB | environ 20% | environ 90% |
| Inflation | 1,3% | −1,4% (septembre) |
Pour la BNS, la situation au début de l’année 2015, au moment de la suppression du cours plancher, était tout autre que celle qui prévalait en septembre 2011, avant l’introduction de cet instrument. En 2011, le problème était la force du franc; début 2015, le problème était en revanche lié à la faiblesse de l’euro, découlant de la crise persistante de la dette souveraine, des difficultés de la Grèce et de l’assouplissement quantitatif annoncé par la Banque centrale européenne (BCE). Dans ces circonstances, la poursuite de la politique axée sur le cours plancher n’aurait pas été soutenable dans la durée. La BNS aurait dû continuellement défendre le cours plancher à travers des interventions sur le marché des changes. Cela lui aurait non seulement fait perdre le contrôle du bilan mais aussi, au final, de la politique monétaire. La BNS a agi alors qu’elle disposait encore de sa capacité d’action. Thomas Jordan a insisté sur le fait que si la BNS n’a jamais hésité à augmenter son bilan, les bénéfices induits par une telle extension devaient être supérieurs aux coûts. Il est pleinement conscient que la suppression du cours plancher représente un grand défi pour de larges pans de l’économie et qu’il pèsera sur les bilans ainsi que sur la conjoncture. Cependant, à la différence de 2011, le franc n’est plus aussi fortement surévalué aujourd’hui par rapport aux autres monnaies importantes.
Thomas Jordan a également reconnu que les taux d‘intérêt négatifs sont un instrument inhabituel pouvant éventuellement présenter des effets secondaires. Sur le long terme, des taux bas ou négatifs pourraient créer une distorsion dans l’allocation des ressources économiques et, en particulier, conduire à une augmentation des prix immobiliers et à une accélération de la croissance des crédits. Cependant, dans la situation actuelle, en plus de la disposition de la BNS à intervenir sur le marché des changes, les taux négatifs constituent un instrument de politique monétaire important et incontournable permettant de réduire l’attractivité du franc. Les éventuels effets négatifs des taux bas en vigueur depuis 2008 sont en outre restés modérés. Grâce aux mesures d’autoréglementation des banques et au volant anticyclique de fonds propres, la situation sur le marché de l’immobilier est en grande partie sous contrôle. De même, on observe actuellement un ralentissement de la croissance des crédits. De plus, les taux négatifs ne concernent au maximum que 5% des actifs du système bancaire et 5% des actifs des caisses de pensions.
Thomas Jordan a admis qu’une inflation faiblement positive serait certes meilleure pour l’économie, mais le taux de renchérissement négatif actuel fait partie du processus d’adaptation consécutif à l’appréciation du franc. Il est important que l’économie garde sous contrôle les coûts unitaires du travail face aux concurrents étrangers. Le président de la Direction générale de la BNS a en outre confirmé la résistance étonnante de l’économie suisse, la croissance ayant déjà quelque peu progressé au deuxième trimestre après un léger recul au premier trimestre.
Pour terminer, Thomas Jordan a rappelé que la BNS ne pouvait pas influencer l’environnement international complexe des marchés financiers. Elle doit créer des conditions monétaires qui permettent l’accomplissement à moyen terme de son mandat constitutionnel. Il n’est malheureusement pas toujours possible d’éviter complètement une inflation temporairement sous-optimale.
Il ne s’agit pas d’une question de perspective
Le scepticisme à l’encontre de la politique monétaire actuelle des banques centrales a marqué la discussion finale en plénum : le plus grand risque lié au taux de renchérissement négatif est l’augmentation des coûts pour les entreprises. Cela freine les investissements, car les salaires nominaux sont peu flexibles vers le bas. La politique monétaire expansionniste alimente en revanche des inquiétudes d’une autre nature, à savoir que cette politique pourrait conduire à une inflation, comme cela s’est déjà produit dans les années 1960 et 1970.
La question de savoir si les taux d‘intérêt négatifs sont compatibles avec un système d’économie de marché ne sera pas résolue scientifiquement mais pragmatiquement. En principe, ces taux négatifs constituent un «corps étranger» dans l’arsenal des banques centrales, mais ils sont un mal nécessaire dans la situation actuelle. Dans l’ensemble, une impression prédomine : trop de distorsions ayant un impact à long terme sont acceptées à la légère pour résoudre des problèmes du court terme – que cela soit dans une perspective globale, européenne ou suisse.